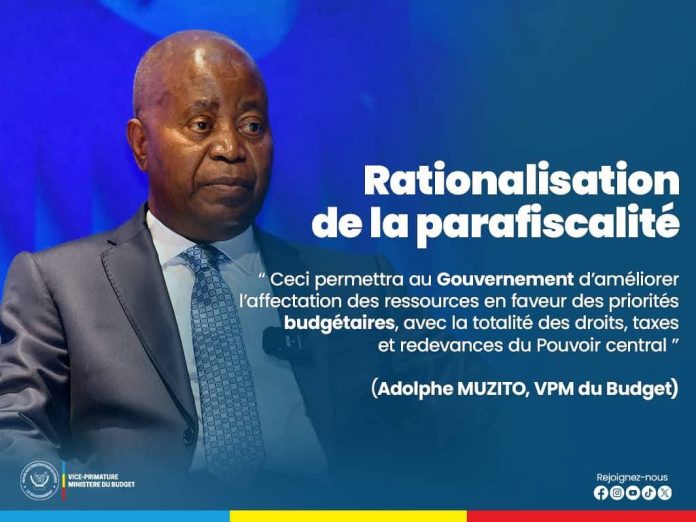La République démocratique du Congo (RDC) replonge dans le cercle vicieux de l’endettement. Le vice-premier ministre du Budget, Adolphe Muzito, a récemment révélé que la dette extérieure du pays s’élève désormais à 16 milliards USD. Un chiffre qui contraste fortement avec les acquis de la période 2004-2010, lorsque la RDC avait bénéficié de l’allégement de la dette dans le cadre de l’Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), ramenant son stock de dettes à environ 2,9 milliards USD. Cette remontée spectaculaire interroge sur la soutenabilité de la dette congolaise et les perspectives économiques du pays.
Le retour d’un fardeau pesant
Au lendemain de l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE en 2010, la RDC avait retrouvé une marge de manœuvre financière. Les efforts de restructuration avaient permis de libérer des ressources pour les investissements publics, notamment dans les infrastructures et les services sociaux. Cependant, à peine une décennie plus tard, le pays voit son endettement extérieur exploser. Selon les chiffres communiqués, la dette actuelle est plus de cinq fois supérieure à celle enregistrée après l’allégement, soulevant des inquiétudes sur la capacité de l’État à honorer ses engagements.
Plusieurs facteurs expliquent cette accumulation rapide. D’une part, la dépendance accrue aux financements extérieurs pour soutenir les projets d’infrastructures et stabiliser le budget national. D’autre part, les chocs économiques notamment la chute des cours des matières premières, la pandémie de Covid-19 et les tensions sécuritaires ont poussé l’État à recourir davantage à l’endettement. Enfin, la faiblesse structurelle de la mobilisation des recettes internes accentue le recours aux prêts extérieurs.
Il faut noter que la RDC reste fortement dépendante de l’exportation de ses ressources minières (cuivre, cobalt, coltan), dont la volatilité des prix rend les finances publiques vulnérables. Le pays n’a pas encore réussi à diversifier suffisamment son économie pour créer une base fiscale solide et résiliente.

L’accroissement de la dette extérieure comporte des risques multiples. D’abord, le service de la dette (intérêts et remboursement du capital) pourrait absorber une part croissante du budget national, au détriment des dépenses sociales et des investissements productifs. Ensuite, la dépendance aux bailleurs de fonds limite l’autonomie budgétaire et expose le pays aux conditionnalités contraignantes imposées par les institutions financières internationales.
De plus, une dette excessive pourrait peser sur la notation de crédit de la RDC et décourager les investisseurs privés. Dans un pays qui cherche à attirer des capitaux pour financer son développement, une telle perception de risque est un frein majeur.
Pour éviter une crise de la dette, plusieurs pistes sont envisageables :
- Renforcer la mobilisation des recettes internes : améliorer le système fiscal, lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et digitaliser les recettes pour sécuriser les finances publiques.
- Améliorer la gouvernance des emprunts : assurer la transparence dans la gestion de la dette, publier régulièrement les statistiques et conditionner les nouveaux prêts à des projets générateurs de revenus.
- Diversifier l’économie : investir dans l’agriculture, l’industrie locale et les services afin de réduire la dépendance aux exportations minières.
- Miser sur les partenariats public-privé : mobiliser les financements privés pour les infrastructures afin de limiter le recours aux emprunts souverains.
L’alerte lancée par Adolphe Muzito doit être entendue comme un signal fort. La RDC, qui a déjà connu les affres d’une dette insoutenable, risque de répéter les erreurs du passé si aucune stratégie cohérente n’est adoptée. Le pays dispose de ressources naturelles abondantes et d’un potentiel économique considérable. Mais sans une gestion rigoureuse de la dette et une politique de diversification, ce potentiel pourrait rester hypothéqué par le poids croissant des engagements financiers.
L’enjeu est double : préserver la stabilité macroéconomique et garantir que les emprunts contractés aujourd’hui servent réellement au développement de demain. À défaut, la génération future pourrait hériter d’un fardeau financier difficilement surmontable.